|

 Parmi les trois premiers films, Indiana Jones et le temple maudit est sans aucun doute celui qui divise le plus. Tout le monde s’accorde sur la qualité du premier et les opinions sont disparates concernant le troisième, mais pour ce second chapitre, il apparaît comme le plus polarisateur. De l’avis même des créateurs, il s’agit du film le plus faible. Lorsque la saga n’était encore qu’une trilogie, il semblait d’ailleurs bizarrement exclu du groupe là où le premier et le troisième entretiennent nombre de points communs (Sallah, Marcus, les nazis, l’Afrique du Nord). Pour la majorité des spectateurs également, il demeure probablement le plus mal aimé. Et pourtant, beaucoup considèrent le film comme leur préféré et il s’avère que c’est parfois pour les mêmes raisons que d’autres le trouvent en deçà des deux autres. Expliquons-nous. Très loin d’être honteuse, cette séquelle respecte à la lettre (et peut-être même trop) le cahier des charges imposé par une suite. En résulte alors un film qui répond peut-être trop à la formule et donne trop ouvertement dans la surenchère au détriment des aspects humain et sérieux qui se dégagent du précédent et du suivant. A la noblesse du pouvoir divin évoqué par l’Arche ou le Graal se substituent des rituels païens à la limite du grand guignol. A l’intrépide Marion succède la demoiselle en détresse Willie, qui passe sont temps à hurler et à geindre. Si l’influence des serials, du comic book et du cartoon se ressentait déjà dans Les Aventuriers de l’Arche perdue, elle se retrouve ici amplifiée. Ce qui est too much pour les uns fait le bonheur des autres. Cependant, une fois de plus, le film discourt sur les obsessions chères à leur auteur. Parmi les trois premiers films, Indiana Jones et le temple maudit est sans aucun doute celui qui divise le plus. Tout le monde s’accorde sur la qualité du premier et les opinions sont disparates concernant le troisième, mais pour ce second chapitre, il apparaît comme le plus polarisateur. De l’avis même des créateurs, il s’agit du film le plus faible. Lorsque la saga n’était encore qu’une trilogie, il semblait d’ailleurs bizarrement exclu du groupe là où le premier et le troisième entretiennent nombre de points communs (Sallah, Marcus, les nazis, l’Afrique du Nord). Pour la majorité des spectateurs également, il demeure probablement le plus mal aimé. Et pourtant, beaucoup considèrent le film comme leur préféré et il s’avère que c’est parfois pour les mêmes raisons que d’autres le trouvent en deçà des deux autres. Expliquons-nous. Très loin d’être honteuse, cette séquelle respecte à la lettre (et peut-être même trop) le cahier des charges imposé par une suite. En résulte alors un film qui répond peut-être trop à la formule et donne trop ouvertement dans la surenchère au détriment des aspects humain et sérieux qui se dégagent du précédent et du suivant. A la noblesse du pouvoir divin évoqué par l’Arche ou le Graal se substituent des rituels païens à la limite du grand guignol. A l’intrépide Marion succède la demoiselle en détresse Willie, qui passe sont temps à hurler et à geindre. Si l’influence des serials, du comic book et du cartoon se ressentait déjà dans Les Aventuriers de l’Arche perdue, elle se retrouve ici amplifiée. Ce qui est too much pour les uns fait le bonheur des autres. Cependant, une fois de plus, le film discourt sur les obsessions chères à leur auteur.

 A cette époque dans les années 80, George Lucas sort d’un divorce, Steven Spielberg essuie également une rupture et la règle officieuse des « numéros 2 » selon laquelle une suite se doit d’être plus sombre (cf. L’Empire contre-attaque) s’est appliquée d’elle-même. Cette fois-ci, c’est Lucas et non Spielberg qui dégotte ses scénaristes à lui pour écrire le film en la personne de Willard Huyck et Gloria Katz, qui ont rédigé autrefois le manuscrit d’American Graffiti pour le producteur (mais également Howard le canard). Indiana Jones et le temple maudit est le seul des autres films dont le scénario n’est pas signé par l’un des hommes de Spielberg. Lucas et Spielberg choisirent de citer l’un des films préférés du metteur en scène, l’adaptation par George Stevens du poème de Rudyard Kipling, Gunga Din, en reprenant la secte des Thugs et leur adoration de la déesse Kali. Huyck et Katz y ajoutèrent une mixture de cultures variées : cardiatomie aztèque, sacrifice volcanique hawaïen, etc., parachevant l’impression de « festival » qui émane de nombreuses séquences du film. Ainsi le film s’ouvre-t-il sur une scène (littéralement) où se livre un numéro de comédie musicale à la Busby Berkeley avant de montrer un Indiana Jones plus « bondien » que jamais (le smoking blanc à la 007) et le tout se termine en un capharnaüm gigantesque où se confondent diamants et glaçons et antidote. Le film affiche cela dit une certaine richesse assez jouissive dans ce trop-plein d’idées, mettant très souvent deux actions en parallèle pour souligner l’aspect comique des séquences (Willie Vs. les animaux de la jungle tandis que Jones se dispute aux cartes avec Demi-Lune, Willie Vs. les insectes tandis que Jones et Demi-Lune vont se faire écraser) ou pour habiller certains passages d’exposition (le repas aux plats dégoûtants, qui comprend notamment des plans ajoutés après le premier montage, pour faire « encore plus »). A cette époque dans les années 80, George Lucas sort d’un divorce, Steven Spielberg essuie également une rupture et la règle officieuse des « numéros 2 » selon laquelle une suite se doit d’être plus sombre (cf. L’Empire contre-attaque) s’est appliquée d’elle-même. Cette fois-ci, c’est Lucas et non Spielberg qui dégotte ses scénaristes à lui pour écrire le film en la personne de Willard Huyck et Gloria Katz, qui ont rédigé autrefois le manuscrit d’American Graffiti pour le producteur (mais également Howard le canard). Indiana Jones et le temple maudit est le seul des autres films dont le scénario n’est pas signé par l’un des hommes de Spielberg. Lucas et Spielberg choisirent de citer l’un des films préférés du metteur en scène, l’adaptation par George Stevens du poème de Rudyard Kipling, Gunga Din, en reprenant la secte des Thugs et leur adoration de la déesse Kali. Huyck et Katz y ajoutèrent une mixture de cultures variées : cardiatomie aztèque, sacrifice volcanique hawaïen, etc., parachevant l’impression de « festival » qui émane de nombreuses séquences du film. Ainsi le film s’ouvre-t-il sur une scène (littéralement) où se livre un numéro de comédie musicale à la Busby Berkeley avant de montrer un Indiana Jones plus « bondien » que jamais (le smoking blanc à la 007) et le tout se termine en un capharnaüm gigantesque où se confondent diamants et glaçons et antidote. Le film affiche cela dit une certaine richesse assez jouissive dans ce trop-plein d’idées, mettant très souvent deux actions en parallèle pour souligner l’aspect comique des séquences (Willie Vs. les animaux de la jungle tandis que Jones se dispute aux cartes avec Demi-Lune, Willie Vs. les insectes tandis que Jones et Demi-Lune vont se faire écraser) ou pour habiller certains passages d’exposition (le repas aux plats dégoûtants, qui comprend notamment des plans ajoutés après le premier montage, pour faire « encore plus »).

 Cette escalade atteint son paroxysme lorsque l’action se situe dans le temple en soi avec évidemment l’arrachage de cœur mais également la poursuite en chariots où, adoptant une démarche faisant preuve d’une réflexivité métafilmique inattendue pour ce genre de produit, le scénario et la mise en scène assument l’aspect « rollercoaster » par lequel on qualifie souvent le cinéma d’action avec sa structure en « montagnes russes ». Indiana Jones et le temple maudit serait-il alors un gros parc d’attractions vide ? Le caractère outrancier de l’entreprise pourrait porter à le croire mais ce serait passer outre certaines explorations thématiques qui rendent comptent à nouveau du sceau de Spielberg et qui prennent le relais de celles du premier film, perdurant l’arc narratif du héros au travers des quatre épisodes. Si dans le premier volet Indiana Jones faisait figure d’enfant, c’est dans ce film qu’il commence peu à peu à mûrir. Le long de la première moitié du film, il demeure très infantile, son sidekick n’est d’ailleurs nul autre qu’un gosse, Demi-Lune. Lorsqu’arrive Willie, ils constituent à eux trois une sorte de famille recomposée, dysfonctionnelle comme tant d’autres chez le metteur en scène. A ce titre, le moment le plus important et pertinent du film survient lorsqu’Indy, sous l’emprise du « sommeil noir » dû au sang de Kali qu’il a bu, attache Willie et s’apprête à l’envoyer dans les flammes et pousse également Demi-Lune au sol avec violence avant que ce dernier ne vienne le « réveiller » en le brûlant. De ce fait, nous avons une scène où le père fait souffrir la mère avant d’être rappelé à l'ordre par le fils. Inutile de rappeler le divorce des parents de Spielberg lorsqu’il n’était encore qu’un enfant et le rôle ingrat (absence, abandon) confié par conséquent aux figures paternelles au travers de la première partie de sa filmographie. Une récurrence thématique qui verra justement un tournant s’enclencher avec…Indiana Jones et la dernière croisade. Cette escalade atteint son paroxysme lorsque l’action se situe dans le temple en soi avec évidemment l’arrachage de cœur mais également la poursuite en chariots où, adoptant une démarche faisant preuve d’une réflexivité métafilmique inattendue pour ce genre de produit, le scénario et la mise en scène assument l’aspect « rollercoaster » par lequel on qualifie souvent le cinéma d’action avec sa structure en « montagnes russes ». Indiana Jones et le temple maudit serait-il alors un gros parc d’attractions vide ? Le caractère outrancier de l’entreprise pourrait porter à le croire mais ce serait passer outre certaines explorations thématiques qui rendent comptent à nouveau du sceau de Spielberg et qui prennent le relais de celles du premier film, perdurant l’arc narratif du héros au travers des quatre épisodes. Si dans le premier volet Indiana Jones faisait figure d’enfant, c’est dans ce film qu’il commence peu à peu à mûrir. Le long de la première moitié du film, il demeure très infantile, son sidekick n’est d’ailleurs nul autre qu’un gosse, Demi-Lune. Lorsqu’arrive Willie, ils constituent à eux trois une sorte de famille recomposée, dysfonctionnelle comme tant d’autres chez le metteur en scène. A ce titre, le moment le plus important et pertinent du film survient lorsqu’Indy, sous l’emprise du « sommeil noir » dû au sang de Kali qu’il a bu, attache Willie et s’apprête à l’envoyer dans les flammes et pousse également Demi-Lune au sol avec violence avant que ce dernier ne vienne le « réveiller » en le brûlant. De ce fait, nous avons une scène où le père fait souffrir la mère avant d’être rappelé à l'ordre par le fils. Inutile de rappeler le divorce des parents de Spielberg lorsqu’il n’était encore qu’un enfant et le rôle ingrat (absence, abandon) confié par conséquent aux figures paternelles au travers de la première partie de sa filmographie. Une récurrence thématique qui verra justement un tournant s’enclencher avec…Indiana Jones et la dernière croisade.

 Sous le couvert de l'analyse, on peut même aller jusqu’à dire qu’Indiana Jones et le temple maudit est un film sur la paternité. Dans le village ne vivent plus que des vieillards et des femmes. Aucun enfant. C'est Indiana Jones, à l’issue de l’aventure, qui leur apportera à toutes un enfant, comme s'il avait engrossé une à une toutes les femmes du village. Derrière ses apparences de pur entertainment calibré (dans le sens non-péjoratif du terme), ce deuxième volume renferme une densité qui n’a pas à rougir aux côtés des autres épisodes et même les plus fervents détracteurs ne sauraient citer meilleur film d’aventures en dehors des films de la franchise elle-même. Et pour les autres, ils y retrouvent le Spielberg décomplexé de 1941 ou de certains scènes de Minority Report, qui doivent davantage à Chuck Jones qu’à Philip K. Dick, et la folie de cette mécanique non moins parfaitement huilée sied à l’image qu’ils se font de l’univers d’Indiana Jones : un monde plus grand que nature habité de scènes pour le moins mémorables. Et avec la sortie d’Indiana Jones et le royaume du crâne de cristal, le deuxième épisode ne se retrouve plus esseulé, coincé entre deux films similaires. Sous le couvert de l'analyse, on peut même aller jusqu’à dire qu’Indiana Jones et le temple maudit est un film sur la paternité. Dans le village ne vivent plus que des vieillards et des femmes. Aucun enfant. C'est Indiana Jones, à l’issue de l’aventure, qui leur apportera à toutes un enfant, comme s'il avait engrossé une à une toutes les femmes du village. Derrière ses apparences de pur entertainment calibré (dans le sens non-péjoratif du terme), ce deuxième volume renferme une densité qui n’a pas à rougir aux côtés des autres épisodes et même les plus fervents détracteurs ne sauraient citer meilleur film d’aventures en dehors des films de la franchise elle-même. Et pour les autres, ils y retrouvent le Spielberg décomplexé de 1941 ou de certains scènes de Minority Report, qui doivent davantage à Chuck Jones qu’à Philip K. Dick, et la folie de cette mécanique non moins parfaitement huilée sied à l’image qu’ils se font de l’univers d’Indiana Jones : un monde plus grand que nature habité de scènes pour le moins mémorables. Et avec la sortie d’Indiana Jones et le royaume du crâne de cristal, le deuxième épisode ne se retrouve plus esseulé, coincé entre deux films similaires.
Robert Hospyan |
 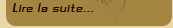
 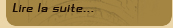
 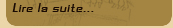
 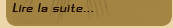 |


