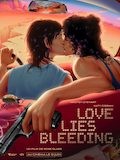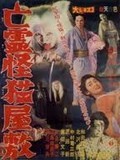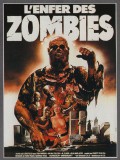Waterproof

Mars 1986, Daniel Larrieu, en résidence au CNDC d'Angers, crée avec sa compagnie Astrakan le spectacle subaquatique Waterproof. Investissant la piscine municipale d'Angers, le chorégraphe signe un spectacle innovant et décalé, qui se dédouble en une vidéodanse de vingt-deux minutes réalisée par Jean-Louis Le Tacon et Luc Riolon. Dans un décompte apnéique couleur piscine, Daniel Larrieu plonge le spectateur dans un monde où jeu de caméra, couleurs, lumières, sons et eau sont autant d'éléments prêts à modeler le corps et la gestuelle du danseur
UNE PISCINE, DES DANSEURS, UNE CAMERA…
Un dispositif simple, un trio insolite et pour le moins surprenant qui dépasse les conventions établies. La scène est ici transformée en un espace à trois dimensions, fluide, mouvant et pénétrable, permettant aux danseurs d'évoluer dans, sous, sur, autour et avec l'eau. Ils deviennent ainsi des sortes d'êtres amphibies vêtus de simples maillots noirs une pièce ou de cirés vert kaki, parfois affublés d'accessoires (lunettes, flotteurs, nœud papillon…) accentuant le décalage de la situation. Le tout est scruté et disséqué par une caméra venue des profondeurs. Au départ fixe, sous l'eau, à mi-hauteur, comme regardant à travers l'un des éclairages de la piscine, elle capte les contorsions des danseurs qui défilent un à un devant son objectif. Peu à peu, elle se déplace dans des travellings et panoramiques flottants, perçant occasionnellement la surface au gré de l'évolution des danseurs. Puis, se renversant, elle adopte des angles radicaux ou inusités pour épouser et souligner les formes et lignes de la piscine et des corps.
KALEIDOSCOPE
A ces parcours et retournements de caméra s'ajoute une esthétique filmique constamment changeante. Alternant la couleur (en particulier les camaïeux de bleu), le noir et blanc et le sépia, poussé parfois jusqu'au rouge, L. Riolon et J.L. Tacon utilisent admirablement toutes les possibilités que leur offre le médium vidéo. Ralentis, filtres, surexposition, les vidéogrammes sont traités avec une attention particulière. Sans transition, ils passent d'une plastique à l'autre, du lisse légèrement bleuté au grisonnant quasi rugueux, comme si la pellicule avait été altérée par l'eau de la piscine, du rouge criard faisant ressortir des corps noirs ralentis au vert d'eau blafard sculptant la chair. Compositions colorées léchées, précises, ces images regorgent de jeux de lumières, d'ombres et de reflets. Lumières vibrantes et irisées, décomposées par le prisme de l'eau se projetant sur les corps en petites vagues. Lumières chaudes filtrant à travers la surface en rayons vaporeux décuplant les lignes de la piscine. Lumières violentes, rasantes, accentuant les couleurs bleu turquoise et orange des flotteurs. Ombres des danseurs se découpant sur les petits carreaux blancs de la piscine. Reflets des visages à la surface de l'eau.
Pour juxtaposer, associer et donner un rythme à ces différentes images de rencontre entre danse, eau et caméra, Luc Riolon a utilisé un montage-cut plus ou moins rapide. Parfois perturbé par de légers fondus-enchaînés et jouant sur les échelles de plans, cet assemblage savamment étudié appuie l'aspect incongru des prises de vue utilisées. Le tout est structuré en six parties distinctes de par leur esthétique et leur gestuelle. Pour les relier, Daniel Larrieu s'est servi dans un premier temps de courtes scènes de transitions introduisant des éléments à venir (comme par exemple la première transition montrant l'ombre d'un danseur s'apposer sur une ligne du fond de la piscine, qui annonce ainsi le fait que les danseurs sont sortis de l'eau), puis de la musique la faisant continuer sur plusieurs séquences. Le traitement sonore de Waterproof est d'ailleurs en adéquation totale avec l'esthétique des scènes qu'il lie et délimite. D'un air d'opéra allemand, on passe à un calme aquatique ponctué de bruits de plongeons amplifiés. A un silence quasi mortuaire accentuant l'état de flottaison des danseurs s'appose un morceau de rock tonitruant typique des années 80, qui se place comme écho à la plastique même de la scène. Le tout se finissant sur une musique répétitive proche de l'incantation divine, qui transpire jusque dans les mouvements répétitifs et flottants des danseurs.
SCULPTURES AQUATIQUES
Cette esthétique aux multiples facettes, cette idée de pluralité et d'interaction des éléments entre eux se retrouve dans la gestuelle même mise en place par Daniel Larrieu. A la manière des images de l'œuvre vidéo, la trame chorégraphique de Waterproof alterne sérieux et frivole, calme et violence. Mis en évidence par les cadrages insolites, les gestes des danseurs sont précis, ciselés, épurés, composant des figures géométriques et créant une certaine architecture du mouvement. On retiendra en particulier la séquence des danseurs en cirés qui, après avoir plongé en ligne et s'être déshabillés, se regroupent pour former une masse aquatique, délavée par la lumière blafarde se reflétant sur l'eau. Regorgeant d'énergie, les corps à la fois athlétiques et sensuels ondulent dans cet univers flottant. Cette dualité est mise en avant en particulier dans une scène de duo où l'homme extirpe de l'eau, caresse et replonge sa partenaire dans la piscine dans un perpétuel état de va et vient.
Mais par-dessus tout, ce sont des gestes intuitifs et flottants qui ressortent de cette pièce. Dès la première scène, les danseuses exécutent des volutes sous l'eau, se maintenant en équilibre instable grâce à ces petits mouvements de bras que l'on retrouve dans les exécutions de natation synchronisée. Ici, la gestuelle est directement issue du milieu qui l'entoure. Les danseurs évoluent dans, mais également avec l'eau, s'en servant à la fois de support et de modèle, explorant toutes les possibilités de mouvement qu'elle offre. Jeu de poids, de contre poids et de rebond dans un duo athlétique. Jeu de balance, de flottaison, de bascule dans une scène violente, électrique, marquée par la trace des années 80. Flottaison également dans ces corps laissés en apnée, immobiles, à la surface ou entre deux eaux, sous lesquels se promène un homme ralenti dans sa course par la résistance de l'eau. Cette exploration de l'espace et du corps se termine en une apothéose de lumières et de reflets. Inversant l'image, la surface de l'eau devient un miroir lisse sur lequel les danseurs courent, s'appuient pour s'élancer vers l'infini ou exécuter des contorsions habiles. Déformée, ondulante, scintillante, la chair se mélange à l'eau, transformant les danseurs en sortes d'êtres mythiques capables de marcher sur l'eau et éclairés en leur plexus par une lumière divine.