Elephant
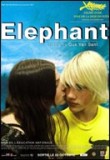
États-Unis, 2003
De Gus Van Sant
Scénario : Gus Van Sant
Avec : Eric Deulen, Carrie Flinkea, Alex Frost, Nicole George, Elias McConnell, Jordan Taylor
Durée : 1h21
Sortie : 22/10/2003






C’est un jour comme les autres qui débute dans un lycée américain. Le soleil perce les nuages, les élèves s’affairent aux abords de la bâtisse et les couloirs s’animent de ses corps sans noms.
C’EST UNE BELLE JOURNEE
Ciel de traîne sur le crâne de Marion Crane. Les cieux finissent par se déchaîner sur sa miséricorde alors que les nuages étaient plutôt cléments dans My Own Private Idaho, laissant percer un soleil qui éclaire une maison fantasmée. Les personnages de Gus Van Sant semblent vivre dans le même monde, sous une même voûte céleste aux humeurs changeantes comme les affaires auxquelles ils se heurtent. Non-événement dans Elephant: l’azur est paisible, et le jour se lève comme mille autres. L’éther ne révèle encore rien de ce qui se trame, ou plutôt tout de ce qui va arriver: le quotidien insoupçonnable n’a pas encore laissé apparaître ses nuages menaçants. Van Sant, s’il situe ses figures sur une même planète (à Manhattan, dans l’Idaho, le désert américain, ou dans un motel au bord de l’autoroute, peu importe), en profite pour varier les genres et renouveler ses approches. Pur indé, remake exercice de style ou commande lissée de studio, Gus filme certes un même monde mais dans des couleurs différentes. Avec Elephant, il poursuit sa trilogie expérimentale entamée avec Gerry. Les équations y sont réduites à leur données les plus fondamentales: deux garçons au même nom, et le désert. Quelques jeunes inconnus, et un lycée. Et Gus de les filmer, en espérant capter leur trésor.
LE TEMPS EST UN JOUEUR AVIDE
Pour ce faire, Van Sant adopte un dispositif totalement différent des canons standardisés façon Will Hunting, qu’il s’agisse d’un point de vue formel ou narratif. Le récit épuré épouse plus que jamais les courbes d’une mise en scène des plus sensorielles. Si ce ne sont des mots, ce seront les sens qui parleront. Amputant son film d’un schéma narratif immédiatement identifiable, Van Sant étire d’autres perceptions pour compenser le "manque". Le temps est distendu et s’allonge à perte d’horizon comme les dunes du désert ou les infinis couloirs du lycée. Les mêmes situations se chevauchent selon les points de vue, faisant de la temporalité un gigantesque puzzle que chaque protagoniste (devenu indispensable) complète de sa pièce et à sa guise. Le décor renfermé devient un immense labyrinthe dont les vastes dédales se croisent et se recroisent comme dans un piège inéluctable, où les souris grouillent sans se soucier des griffes qui les guettent. L’usage du format 1.33 contribue à cette impression démesurée en offrant un champ de vision complet de chaque galerie à la profondeur renforcée. La caméra du réalisateur se perd ainsi dans le tournis des carrelages brillants afin de planter solidement le théâtre de sa tragédie. Pour transcender l’antithétique événement quotidien, Van Sant rend d’abord surnaturelles son unité de lieu (un lycée des plus communs, devenu labyrinthe du Minotaure) et son unité de temps (une journée pour une éternité). Reste aux acteurs d’entrer en scène.
I’M HEAD OF THE CLASS, I’M POPULAR
Gus Van Sant s’est souvent penché sur les fondements branlants de personnages adolescents déployant leur panneau "en construction". Mike cherche ses racines, Jimmy se console à coups de reins dans une présentatrice météo, tandis que Will Hunting et Jamal Wallace ont trouvé leurs pères de substitution. Dans Elephant, il n’y a plus de quête. Les traces de pneu du bolide saoul d’un père qui ne l’est pas moins sont les seuls ivres indices de figure patriarcale dans un univers de gosses, où ce sont ces derniers qui doivent s’occuper des anciens. Le désir est désormais sur la propre peau juvénile, et l’image sociale en est le reflet indispensable. La pimpette au chewing-gum, le photographe romantique, le sportif sexy, la nerd esseulée, chacun traîne ou arbore son étiquette de lycéen, jouant leur rôle à leur place dite dans leur mini-société. Hors de cette organisation, il y a ceux qui sont sans noms, ceux qui sont d’ores et déjà mis au ban car non homologués. C’est dans leurs cœurs que naît la haine qui fera basculer la journée comme les autres en crépuscule infernal. "Peut-on reconnaître un couple d’homosexuels?", demande un professeur à des élèves réunis en cercle autour de lui. Mais peut-on reconnaître des tueurs? Le sportif est-il une simple image d’Épinal? Qu’en est-il de la Lolita, ou du garçon bohème qui s’occupe de son père comme de son fils? Les vignettes sont là, repères essentiels à une construction de soi. Elles n’en sont pas moins relativement obsolètes, jusqu’à être rejetées dans la furie la plus totale par les laissés pour compte du chantier de construction, qui eux-mêmes cherchent de sombres oasis dans les clichés d’imagerie nazi – finalement, le diable n’est ici qu’un bibelot en plastique accroché au rétroviseur. Mais si je n’ai pas de marque, je n’existe pas. Dans un système où la compétition est sur tous les murs, la solution, c’est la négation, si ce n’est de soi, celle des autres.
THE VIRGIN SUICIDES
Elephant peut être parfaitement vu comme un passage à l’action des théories Bowling for Columbine, s’inspirant d’ailleurs largement du drame sanglant du lycée homonyme, où une dizaine de jeunes gens ont été assassinés par deux d’entre eux. Pourtant, l’oeuvre de Van Sant est avant tout le portrait de cette adolescence mélancolique, monstrueuse puisque les humains y sont encore dans un entre-deux schizophrénique, disloqué entre enfance et âge adulte. Le réalisateur capture en de sourds coups de filet les battements d’ailes de papillons éphémères, inconscients de leur possible fin et donc mis en permanence sur ce fil d’équilibrisme, sans peur, entre vie et mort. La mort est un jeu vidéo, on la prend d’ailleurs en photo comme un couple d’amoureux dans un jardin. Elle n’a pourtant plus rien de romantique, cette chair musclée rendue froide dans un réfrigérateur morbide. Les murs suintent de leur angoisse muette comme témoins impuissants d’une irréductible tragédie. Pourtant, Van Sant parvient à s’échapper des carnations blanchies et défuntes en donnant à voir leurs âmes flottantes.
EN APESANTEUR
Pour s’échapper du glauque, Elephant nécessitait un certain doigté pour ses coutures les plus sensibles. Gus Van Sant était l’homme de la situation: son film est purement et simplement touché par la grâce, en constante apesanteur des premiers aux derniers nuages. Hantée par le bienveillant fantôme de Stanley Kubrick, la steadycam du réalisateur confère un aspect aérien aux multiples déambulations de couloirs qui prennent les teintes de chemins d’Eden, sillons célestes comme tranchées infernales dans son ambivalent décor, parcouru de plans-séquences au temps suspendu. Lettre à Elise dont les notes sont chuchotées au piano, Sonate au clair de lune accompagnant la danse macabre d’un bras qui s’étend vers les cieux, pour former une première esquisse ou un mouvement initial de ballet mortuaire, Elephant est également porté par un univers sonore en forme de paysages aux lointains échos diffus, de plages électroacoustiques comme répercutions prématurées du KO étourdissant. Les anges sont alors réduits à de chancelantes ombres lointaines. La caméra retrouve les cieux, son regard discret se porte ailleurs. La parenthèse éprouvée se referme le plus simplement possible et préfère détourner les yeux du dénouement horrible. Van Sant ne propose pas de solution à un problème de société, n’impose guère de point de vue, ne se soucie plus de l’après – il en a déjà assez dit. La course pathétique de l’éléphant s’achève, interdite, un genou à terre. Gus Van Sant signe là son chef-d’œuvre de porcelaine, dont l’élégance cosmique n’a d’égale que son éperdue puissance.







