





 |
|

|
Père de famille sans histoire, Tom McKenna tue deux agresseurs en état de légitime défense. Il devient malgré lui un personnage médiatique. De mystérieux hommes en noir viennent frapper à sa porte...
|
|
|

Depuis M. Butterfly en 1994, film qui marque d'ailleurs l'abandon ( eXistenZ mis à part) des effets spéciaux dans le cinéma de David Cronenberg, la mutation, génétique, physiologique, ou cérébrale, n'est plus irréversible. Devenue femme pour lui soutirer des renseignements de secret |
|
défense, Butterfly effectue, dans le fourgon blindé qui les mène au Palais de Justice, au cours d’une scène bouleversante de sobriété, de retenue, une ultime transfor- mation, un dernier retour dans sa chrysalide, démontrant à son amant que les limites d'un état à l'autre sont floues et toujours franchissables. La méta- morphose, guidée par un traumatisme profond et charnel qui bouleverse l’organisme (frissons à l’écoute d’un air d’opéra, accident de voiture), est devenue réversible, le chemin d'accès peut être emprunté dans les deux sens, la mutation n'est plus comparable à un virus mortel et irrévocable (La Mouche, Videodrome), ne s’inscrit plus en rupture mais en simple |
|
déformation, voire conservation, des corps. A History of Violence est l'histoire de cette déformation, multiple, céré- brale, sexuelle, qui secoue les membres d'une famille suite à un incident sanglant, se propageant de l’un vers les autres comme une infection. La contamination, donc, thème cher au cinéaste, et qui déforme littéralement les corps, les visages, les êtres, se prolongeant jusqu'au visuel même du film, de la photographie (cristalline et éclatante de Peter Suschitzky, figure habituelle de l'univers du cinéaste, avec qui il travaille pour la septième fois) aux costumes et aux décors, qui s’assombrissent scène après scène. |
| |
|
History, ou His story, son histoire - on sait l'attirance que peut avoir le cinéaste pour les mots, depuis les prénoms "Beverly" et "Eliot" (réduits à "Bev" et "Eli", "Bev-Eli", "Beverly") dans Faux-semblants, jusqu’au titre même de M. Butterfly (le "M" marquant la jonction, ténue, quasi impalpable, entre Mrs. et Mr.). Une histoire de violence, l’Histoire de la Violence, son histoire, celle d’un homme au passé trouble, double, qui sommeille depuis plusieurs années dans un cocon (familial) avant de laisser éclater aux yeux de son entourage son ça, mimésis organique et identité première. Ici, la gémellité est personnifiée par Tom/Joey - interprété par Viggo Mortensen, en qui le cinéaste trouve un nouveau double, après Jeremy Irons |
|
ou James Wood – deux figures d’un même personnage, par lesquelles il transitera selon la scène, selon le moment, en fonction des pulsions de sexe et de mort. Première étape de cette transformation: le revolver, prolongement charnel du poignet avec lequel il fusionne dans Videodrome, pour lequel Cronenberg expliquait que "l’arme fait partie du corps du héros comme l’un de ses organes. Elle s'apparente à une extension monstrueuse". Attribut sexuel et phallique, brandi à la gueule du spectateur, manié comme une simple excroissance de la main à laquelle il reste soudé; mais également archétype de série B policière, genre auquel le film appartient ouvertement, le transcendant et le modulant de l’intérieur, à la manière d’un virus – on y revient. Revolver - que |
|
 Tom/Joey op Tom/Joey oppose, dans un plan renvoyant à un autre, similaire de la magnifique scène d’ouverture, aux deux gangsters venus braquer son magasin, eux-mêmes doubles (le jeune, le vieux, le maître, l'élève...), eux-mêmes métamor- phosés, prolongés par des armes à feu. |
|
|
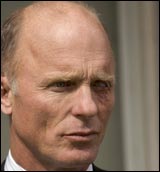 Observation froide et clinique d’un genre, le thriller policier américain, dont Cronenberg déploie tous les stéréotypes dans un plan-séquence d’ouverture écrasant de perfection, A History of Violence a l’apparence d’un film modeste, d’une récréation dans la carrière d’un cinéaste en perte de vitesse depuis deux films |
|
discutés. Pourtant, au cours des différentes strates qui s’imbriquent ou se superposent les unes aux autres, apparaît un projet différent, un regard sur l’Amérique, sur ses symboles, sur cette violence glorifiée par une population solidaire. Film de gangsters (irlandais), road-movie (la première scène, près d’un motel), western (le "gunfight" entre Tom et Carl Fogarty), drame familiale (scènes de couple), teen-movie, le film passe par tous les échelons, qu’il gravit un à un pour s’en détourner, au fur et à mesure. Dans sa structure même, qui navigue d’un point A à un point B, puis d’un point B à un point C, et ainsi de suite, A History of Violence semble en apparence refuser toute modernité, toute tentative de renouvellement des gen- |
|
res, alors que Cronenberg se les approprie bien entendu en profondeur, insidieusement, les menant jusqu’à un final apocalyptique. Rarement le cinéaste a à ce point prolongé les thèmes par la structure du film, par ses contours. Rarement chez Cronenberg fond et formes ont à ce point été scellés, dans un film lui-même en perpétuelle mutation. Porté par la partition douce et discrète de Howard Shore, le compagnon de toujours, le film devient aussi ce parcours d’une famille qui se débat à travers les icônes du cinéma américain. Il fallait bien que le cinéaste, canadien ayant rarement cédé aux sirènes hollywoodiennes si ce n’est pour les transgresser, s’y frotte un jour ou l’autre. |
| |
|
Alors qu’il a toujours évité soigneusement le sujet, si ce n’est en filigrane ou en gage de son inaccessibilité (Chromosome 3, La Mouche, Le Festin nu, M. Butterfly, Crash…), Cronenberg aborde ici frontalement le domaine de la cellule familiale. Que devient la famille alors que l’un de ses composants subit une métamorphose, alors qu’un élément extérieur (le meurtre et la célébrité qui s’ensuit) vient se greffer à elle, la parasitant de l’intérieur (la télévision, les citadins qui attendent Tom à la sortie de l’hôpital)? Comment gérer la transformation du père, ses allers et venues d’une personnalité à l’autre, comment se positionner face à sa soudaine notoriété? Si le personnage |
|
de la petite fille est mis de côté jusqu’à la bouleversante scène finale – où elle effectue le premier et très beau geste salvateur -, celui du garçon, impeccablement interprété par Ashton Holmes, acteur qui trouve ici son premier rôle, subit une mutation soudaine – symbole évident de la puberté. De spectateur victime, il devient acteur et agresseur, se révèle contaminé par la violence du père, comme si ce potentiel, ce pouvoir, se transmettait génétiquement pour éclater à la puberté – précepte de base, finalement, des mutants dans le domaine de la bande dessinée, domaine dont est d’ailleurs issu le film. A mesure que s’ébauche son œuvre, film après film, Cronenberg se révèle capable d’affronter des figures qui lui semblaient jusqu’alors inac- |
|
 cessibles. On le découvre ici capable de développer et de diriger un personnage fort, celui d’un adolescent. Passage d’ailleurs transi- toire et monstrueux de l’être humain, qui intéresse probablement plus le cinéaste que celui, figé, de l’enfance. |
|
|

Revenons à Tom/Joey. On le sait, Cronenberg a abandonné les effets spéciaux et les maquillages, choisissant de résoudre tout problème dorénavant par le biais de la mise en scène. D’ailleurs, dans eXistenZ, malgré l’utilisation de la synthèse et des créatures de latex, le passage dans l’autre monde s’effectuait visuellement par un simple champ-contrechamp. On pourrait imaginer, au vu de |
|
ses derniers films, que réalisé quinze ans plus tard, Faux-semblants ne contiendrait plus deux jumeaux, mais un seul, à la personnalité elle-même scindée - idée qui dans un sens se trouvait déjà à l’état embryonnaire dans le film (Cronenberg poussant le commentaire, dans certains entretiens, jusqu’à parler d’un jumeau fantasmé, qui n’existerait pas). Aujourd’hui, cette Piéta moderne qui clôt le destin des frères Mantle trouve un écho dans l’avenir double du personnage de Tom/Joey. Deux visages, deux masques, l’un se superposant à l’autre. Comme Butterfly, il subit sa transformation, intérieure et extérieure, par le simple biais de la mise en scène et de la direction d’acteur. Son visage se déforme sous la douleur, sous la colère, son corps change (blessure, cicatrices, |
|
fauteuil roulant), sa coiffure se modifie imperce- ptiblement - et il faut ici saluer la performance du comédien, qui se glisse sans effort dans le moule cronenbergien. Cet héritage du passé, sur lequel il a fait table rase lors d’un cheminement intérieur et christique aux portes du désert, revient à la charge suite à une décharge d’adrénaline (le braquage du restaurant), scène incroyable de violence et de tension, et pourtant faite de calme et de sérénité dans le montage (Cronenberg refuse toute stylisation de la violence, toute choré- graphie). Et se propage jusqu’au fils, qui subit à son tour les mêmes mutations faciales, les mêmes pulsions assassines. |
| |
|
Au-delà même de la portée actuelle et sociale du titre (la violence comme acte nécessaire et symbole de réussite, dans une société la glorifiant par l’intermédiaire de ses médias), cette pulsion qui anime soudainement Tom/Joey devient une résurgence de son ça, enfermé dans un surmoi aux allures de chrysalide. "La violence suppose un échappement au contrôle: l’explosion émotive se libère en déchaînement paroxystiques, cris et gesticulation, qui atteste l’échec de toutes les disciplines personnelles", écrit Freud. Le rôle du couple, ici, est de tenir l’homme en respect, de le détourner de la pulsion, qu’elle soit de vie (sexe, Eros) ou de mort (violence, Thanatos), pulsion |
|
qu’il enferme dans un déni de réalité – récurrence de l’œuvre du cinéaste, déjà abordée dans Spider ou M. Butterfly. C’est à partir de là qu’il faut prendre ce fil gracile sur lequel se déroule le film, ce rythme lent et sourd brutalement interrompu par des explosions de violence quasi insoutenables. A History of Violence, dans son déroulement et son montage, devient une peinture mouvante des pulsions d’un héros oscillant entre une identité et une autre. Le métrage alterne ainsi scènes familiales, presque enfantines (le premier acte sexuel, présentant Maria Bello en majorette), et décharges électriques incroyables (gros plans détaillés sur des visages éclatés), incessant balancement quasi métrono-mique. Et c’est là |
|
 toute la toute la force du film: tanguer, presque vaciller, d’un genre à un autre, d’un rythme à un autre, sans jamais lais-ser au spectateur la possi-bilité ni même le temps d’anticiper. Qui apparaîtra dans cette scène, Tom ou Joey? A Cronenberg de laisser la surprise qui, n’en doutons pas, sera quoi qu’il arrive percutante. |
|
|
 Allegra, dont le personnage au départ était d’ailleurs un homme, vient dans eXistenZ bouleverser l’œu-vre du cinéaste, de par sa combativité, sa créativité. Quelque soit le film, la femme était jusqu’à présent spectatrice, victime, éventuellement décle- ncheur. Pour la première fois, elle devient actrice. " Dans le film, le résultat de ce |
|
renversement est intéressant par ce qu'il crée d´étrange et de troublant, par la panoplie de gestes singuliers qu'il suppose. C´est l'homme - Pikul (Jude Law) - qui est vierge". Pas de doute, nous sommes loin de Véronica (La Mouche) ou de Claire (Faux-semblants). Ce dépucelage qu’Allegra fait subir à Pikul trouve ici une résonance à travers cette scène troublante dans laquelle Maria Bello "prend les choses en main", se transformant pour l’occasion en pompom girl. Scène incroyable au cours de laquelle Tom, qui a refoulé Joey au plus profond, ne peut rivaliser. Edie (prénom étrangement masculin), sans doute le plus beau person-nage féminin jamais filmé par Cronenberg, femme enfant, femme forte ou femme perdue, mue elle-même - giflant son mari, |
|
lui attrapant la bouche dans une autre scène sexuelle terrassant de violence et d’érotisme, apparaissant ensuite dans l’encadrement d’une porte nue, affaiblie, abandonnée. C’est son monde qui implose avec les révélations de Tom, sa vie qui est remise en cause, jusqu’à son nom (toujours cette importance des mots et des noms). Ce sont les rapports de force qu’elle entretenait avec lui qui sont modifiés. La violence la contamine, l’héroïsme de son mari la terrifie, par ce qu’ils présentent d’inconnu et d’imprévisible. Les choses, en dépit d’une dernière scène émouvante, ne reprendront très probablement jamais leur cours tranquille. |
| |
|
Et parce que le sexe est indissociable de l’œuvre du cinéaste, il occupe forcément une place majeure, dans ce dernier film comme dans les précédents. La fusion des corps et le déchaînement des pulsions passe par la pénétration, acte qui n’apparaît justement pas dans la première scène sexuelle, quasi virginale, limitée aux préliminaires. Parce que les pulsions de vie et de mort sont bien entendu liées, parce que la figure de la pénétration fait acte dans la filmographie du cinéaste, elles opèrent ici aussi une symbiose quasi parfaite, comme c’était par exemple le cas dans Crash. Les corps et les visages sont enfoncés (pénétrés pas une balle de revolver, mais aussi par les poings qui vont et viennent dans un |
|
coït infernal et sanglant). La femme est prise sauvagement dans les escaliers, victime/initiatrice d’un quasi viol durant lequel l’homme manque de l’étrangler. Les bleus, les plaies post-coïtum, sur lesquels s’attarde la caméra, ne sont pas sans rappelés ceux infligés à Deborah Unger (dans Crash, justement). Frénésie de sexe et de violence, dont il va falloir se laver, s’absoudre. "L'homme est, en effet, tenté de satisfaire son besoin d’agression aux dépens de son prochain, (…) de l'utiliser sexuellement sans son contentement", explique encore Freud. Cette tentation, Tom s’y soumet, d’abord contre son gré, puis de façon totalement volontaire, retrouvant ses racines, retrouvant son frère. Frère qu’il faudra tuer, liens avec le passé qu’il faudra briser, |
|
 pulsions qu’il faudra refouler pour reprendre sa petite vie, pour retrouver l’amour de sa femme, celui de ses enfants ainsi que sa place à table. Pourtant… lorsque le présent est en pleine mutation, fait-il toujours le lien entre ce qui le précède et ce qui le suit? |
|
|

|
  |