Twentynine Palms
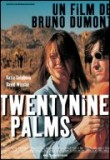
Twentynine Palms
France, 2003
De Bruno Dumont
Scénario : Bruno Dumont
Avec : Katia Golubeva, David Wisak
Durée : 1h59
Sortie : 17/09/2003






Le nouveau film de Bruno Dumont n'est pas un film à suspense classique. Nous tenons toutefois à informer le lecteur que le texte qui suit révèle certains aboutissements du film et qu'il peut donc en gâcher la vision
David roule en direction de la ville de Twentynine Palms, autour de laquelle il doit faire des repérages. Accompagné de Katia avec laquelle il forme un couple amoureux et renfermé sur soi, il va partir à la découverte d’un environnement menaçant.
LE DERNIER MOTEL SUR LA GAUCHE
Point névralgique de l’année cinématographique, le film de Bruno Dumont (lire l'entretien) dévoile un certain envers du décor, par une mise en abyme ironique et prémonitoire, comme pour signifier qu’il va, via l’odyssée terrifiante de ce jeune couple, nous faire traverser un miroir. Celui qui sépare une certaine réalité (l’Amérique profonde) du "film d’art". "Sans doute un film d’art", dit l’un des personnage. C’est ce que le cinéaste nous laisse entrevoir par le filtre de la télévision que regarde constamment David dans la chambre du motel de Twentynine Palms. Quelques images qui se confondent, par un jeu d’écran, avec celles du film de Dumont l’espace d’un instant, quelques secondes durant lesquelles nous sommes confortablement en terrain connu, conquis. Paradoxalement, le cinéaste n’utilisera plus par la suite ce genre de décadrage. Il dessinera régulièrement des cadres à l’intérieur même du champ, notamment dans les scènes filmées à l’intérieur de la voiture, dans lesquelles la vitre constitue une fenêtre vers un extérieur hostile et étranger. Mais la mise en abîme ne sera ni récurrente ni soulignée. Parce que Dumont poursuit avec ce film son entreprise de restructuration des genres, investissant cette fois ces deux macrocosmes américains que sont le road movie et l’horreur, tout en épurant comme à son habitude le champ du surabondant, du superflu, de tous ces détails vains assimilés justement au "film d’art".
Que reste t-il dans le champ? Un squelette, un cadavre, celui de l’Amérique profonde, présentée comme une terre déchue et menaçante, dans laquelle deux amoureux déchaînent la colère des dieux, dans laquelle chaque figurant devient potentiellement hostile et dangereux, dans laquelle la même chanson passe en boucle à la radio. On le sait, Bruno Dumont recherche l’accident sur le tournage - grâce au jeu des acteurs, grâce au son, au décor, etc. - celui qui fera basculer son film du côté vicié, celui qui confèrera à ce couple l’aura destructrice qui lui donne systématiquement l’air d’être au bord de l’implosion. C’est donc par hasard, par accident, que le film se rapproche des classiques dégénérés, piétinant déjà le mythe américain, que sont Massacre à la tronçonneuse, La Dernière maison sur la gauche, ou La Colline a des yeux. Parce que, comme Tobe Hooper ou Wes Craven, comme David Lynch par la suite avec Twin Peaks (avec lequel Twentynine Palms entretient certaines concordances, à commencer pas son titre), Bruno Dumont investit cliniquement un genre, le déstructure de l’intérieur afin de livrer un objet expérimental dans lequel l’angoisse, progressive et croissante, se fait persistante, dans lequel l’environnement décrit est rapidement perçu comme décrépi, emporté à la dérive par le poids de l’échec du rêve américain.
LOST IN PARADISE
Des voitures aux vitres teintées, un générateur bruyant, une serveuse impolie, des jeunes plongeant dans la piscine dans laquelle les deux amants faisaient l’amour… Systématiquement, Bruno Dumont souligne par touches minuscules et anodines le danger qui provient de l’extérieur. Lula comparait le monde qui l’entourait à La Nuit des morts-vivants dans le sublime Wild at Heart de David Lynch. Dumont ne fait que concrétiser ce monde: nous sommes à la frontière d’un paradis perdu, d’un jardin surveillé par les dieux (l’orage permanent mais invisible), autour duquel l’enfer se fait de plus en plus envahissant. A quel monde désenchanté appartiennent ces autochtones dégénérés, navigant sans cesse entre l’état de vie et l’état de mort, entre l’état d’entité figurative éloignée et celui d’acteur de premier plan? Le notre? Celui de Katia et David? Le cinéaste décrit une "vampirisation" du couple par son environnement, une sorte de lutte à l’intérieur du champ pour accéder au premier plan, un viol permanent du cadre (la voiture qui rentre par l’arrière dans celle de David), qui confère au film ce sentiment d’angoisse et de menace qu’il acquiert bien avant les scènes finales. Sentiment d’angoisse qui, paradoxalement, ne provient pas de scènes choquantes ou éprouvantes. Tout le film suit une pente ascendante sans jamais atteindre les véritable pics de terreur propres au genre dans lequel le réalisateur travaille (l’horreur).
Malgré une utilisation splendide du cinémascope, format propre pourtant à générer de nombreuses lignes de fuite, Dumont opère un cadrage serré autour de ses deux protagonistes, créant une sorte de bulle semi-étanche à l’intérieur de laquelle le couple se débat, persuadé d’être en sécurité. Le champ, large ou resserré (Dumont alterne à la façon du Dario Argento des Frissons de l’angoisse), constitue une sphère paradisiaque parfois pénétrée par une menace provenant du hors champ. En récupérant ce procédé propre là aussi au cinéma d’horreur (dans lequel le tueur surgit généralement du hors champ, provoquant sursauts), Dumont confirme le statut infernal de l’environnement décrit. Nous n’avons jamais, par le biais du cadre, d’avance sur le personnage qui découvre systématiquement avant nous la menace qui se présente à lui. Un plan, pourtant anodin, est symptomatique du film, celui dans lequel le couple avance en direction d’un restaurant. La caméra suit le couple, les bordures du cadre n’étant qu’à quelques mètres seulement des deux personnages. Nous ne découvrons qu’après eux l’endroit vers lequel ils s’acheminent. Nous n’avons pas, comme ça pourrait être le cas chez un cinéaste tel que Carpenter, d’avance sur eux. Nous ne savons pas de quoi est constitué le hors champ, mais nous en connaissons les manifestations, qu’elles soient sonores (fabuleux travail sur le son) ou visuelles.
LE FEU MARCHE AVEC MOI
Venu recueillir les derniers souffles du polar américain, Bruno Dumont filme ceux d’un couple au bord du gouffre. Quelle est cette fin que le cinéaste tente de canaliser (le projet initial était un film policier intitulé The End, que Dumont n’a pas pu pour le moment mener à terme, se rabattant sur ce Twentynine Palms, d’apparence plus modeste)? Il y a de véritables fulgurances dans l’odyssée mentale et physique de ces deux êtres, quelques moments de pure beauté durant lesquels l’amour dévaste tout, dépasse tout, y compris la barrière de la langue. Il faut voir la magnifique scène où Katia et David mangent une glace, pour mesurer à quel point Bruno Dumont a su saisir quelque chose, un sentiment, une émotion qui par ailleurs n’existait pas sur le tournage (les deux acteurs se détestant cordialement), étant elle aussi issue d’accidents. Véritables Adam et Eve évoluant dans un jardin s’étalant à perte de vue (le désert, avec ce qu’il implique de fascination et d’effroi), ces deux êtres dans leur totale nudité deviennent les seuls représentants d'un idéal amoureux en perdition. Côtoyant les cieux (la scène dans les rochers), ils cherchent un paradis terrestre, renfermés sur eux-mêmes, imperméables au monde qui les entoure. Ces scènes idylliques constituent les plus beaux moments du film, les plus intenses, les plus purs. Elles constituent également la plus belle antithèse à cette détresse interne et abstraite qui menace le couple.
Il subsiste en effet une incertitude concernant l’amour que les deux protagonistes se portent l’un l’autre. Katia et David sont deux électrons libres gravitant autour d’un noyau proche de l’éclatement. La tension que le film laisse pressentir dès ses premières scènes provient aussi de là, de ce gouffre qui séparent les deux amants du néant. Elle provient également de l’activité sexuelle animale du couple: ici, l’orgasme est douloureux, le corps est profané, la pénétration est difficile. La jouissance, déformant les visages, entraînant des cris bestiaux insensés et grotesques, est comparable à une agression, à un viol. Si ces scènes de sexe renvoient bien entendu à l’image du violeur, que l’on garde en mémoire, hurlant les yeux vers le ciel tandis qu’il éjacule, elles sont également à mettre en parallèle avec l’hystérie profondément dangereuse et imprévisible de Katia. Un regard, une parole, et c’est son monde entier qui s’écroule, sa bulle qui se raye (la peinture de la voiture écaillée par les branches), sa cohésion mentale qui se morcelle. La scène du chien renversé est à ce titre exemplaire, révélant le caractère jusqu’au-boutiste du couple, entre la fausse froideur de l’homme et la névrose pénible et confuse de la femme. En quelques plans, c’est un couple qui s’achemine doucement, lentement, inexorablement, vers sa désintégration, que dépeint Bruno Dumont. Un couple qui s’achemine fatalement vers… La fin.







