I
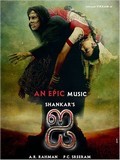
"I" est la lettre la plus simple de l'alphabet occidental. En tamoul, c'est l'inverse. C'est la lettre la plus compliquée. "I" signifie "beauté".
FOLIE FURIEUSE
Les superlatifs manquaient déjà pour rendre justice à la manière dont les bouches étaient restées béantes devant la folie inédite d’Endhiran, l’une des précédentes réalisations de Shankar, qui mêlait dans un grand vent de folie Matrix et saris fluos. Mais parler de mauvais goût quand on approche le cinéma indien est un piège. Les cinéphiles occidentaux peu habitués aux blockbusters indiens ont trop vite fait de tous les ranger dans un même sac, et de les juger à l’aune de critères hollywoodiens, comme si les structures narratives américaines étaient universelles. Comme si elles étaient soit les seules valables, soit toujours les meilleures, pour raconter une histoire. Au contraire, les films de divertissement indiens possèdent leur propre rythme (qu’on ferait bien de leur envier) et surtout leurs propres règles. Si Endhiran pouvait être vu comme la rencontre explosive et ubuesque entre ces deux lupanars de luxe, I ne réconcilie aucune consigne : il piétine les règles.
I est par exemple un film où (même si c’est furtif) les personnages s’embrassent (un geste pourtant presque tabou en Inde), saignent (tout aussi rare), et pire… ils boivent de l’alcool et fument ! Il faut d’ailleurs se pincer pour voir, même sur les copies distribuées en France, des logos de prévention santé incrustés directement sur la pellicule dans chaque plan concerné (bon, pas dans les plans de bisou non plus, n’exagérons rien). Ce réalisme, habituellement réservé en Inde aux films noirs, détonne ici d’autant plus que l’ensemble ne se départit jamais du sacro-saint premier degré. C’est en effet cette absence de cynisme qui porte vers le haut les meilleurs films dansants indiens, car il leur donne la noblesse inattaquable des contes de fées. Mais cette grâce se mérite, et elle reste fragile. Il y a ici des choses qui ne passeraient nulle part ailleurs, tel ce personnage de femme transsexuelle, qui manigance comme une marâtre sortie d’une série B des Philippines. Il y a plus d’une fois de quoi se taper les cuisses de rire mais aussi de sidération joyeuse devant ce qui se passe à l’écran. Pourtant I finit vraiment manquer d’élégance à force d’excès. Un peu comme le tour de grand huit de trop, celui qui commence à coller un mal au bide et qui gâche la vue d’en haut.
Sur une trame classique (pour le genre), faite d’humour simple et de conquête amoureuse, où les scènes de déclarations ressemblent toutes à des pubs pour parfums, Shankar greffe deux genres improbables : le film d’action et le film fantastique. Et dans chaque registre, il va au charbon avec la même subtilité qu’un ouragan. Quand on se bat dans une salle de gym, c’est entre bodybuilders aux corps huileux et aux slips dorés. Quand on chevauche une moto, celle-ci se transforme en bonnasse. Quand on se fait kidnapper par un bossu difforme, c’est pour mieux voir un loup-garou danser parmi les anges (scène tellement over-the-top qu’elle ressemble à nos pubs pour le bœuf, où les démons préparent des steaks hachés). Tout cela s’imbrique dans une structure narrative pas toujours très claire et (défaut bien plus rare) pas toujours très rythmé. Shankar a les yeux plus gros que le ventre, et malgré son plaisir gargantuesque, frôle l’indigestion. Et pourtant il faut bien reconnaitre qu’il voit surtout plus grand et plus loin que les autres. Même si elles sont hélas trop rares, les scènes de chant sont là pour le rappeler : ici les décors sont plus gigantesques qu’ailleurs, les couleurs plus vives, les danses encore plus virevoltantes… Dans ses meilleurs moments, I abat les murs avec une force et une jubilation rares et complètement contagieuses.











